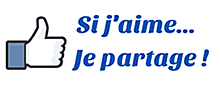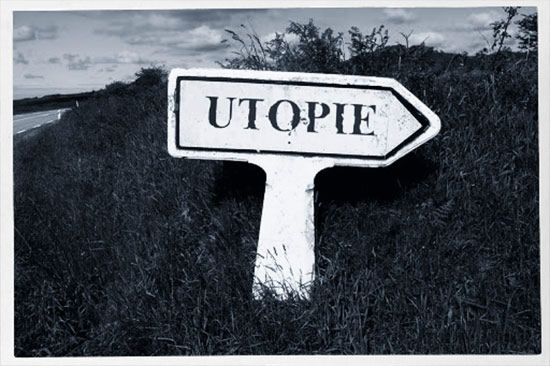
Les contre-utopies ne se limitent pas à la fiction littéraire, et contrairement aux utopies leur expérimentation dans le monde réel semble se vérifier de façon si constante que l’on finit par considérer que la réalité est avant tout dystopique. Les exemples ne manquent pas. Le nazisme en est la plus évidente démonstration avec sa soumission des races inférieures et la primauté de l’élite aryenne. Les contre-utopies sont parfois des tentatives utopiques déçues ou déviées de leur sens, qui se sont transformées en réalisant leur impossible cohabitation avec la réalité. Dans ce domaine nous trouvons le communisme parti pour faire le bonheur d’un peuple au moyen de l’égalité pour tous, et qui va aboutir au délire paranoïaque d’une classe dirigeante incapable d’éviter l’écueil des jalousies, des convoitises et des peurs individuelles.
C’est la littérature avec « La ferme des animaux » d’Orwell ,qui nous offre la plus belle description de la transformation d’une utopie qui en abandonnant ses idéaux égalitaires au profit du pragmatisme se transforme en dystopie. Dès qu’ils ont chassé les hommes pour prendre le pouvoir, les animaux créent fièrement leurs constitution et devise et déclarent que « tous les animaux sont égaux ». Lorsque les cochons à leur tour prendront le pouvoir faisant trimer plus que jamais leurs semblables pour finir par taper le carton avec les hommes, la devise deviendra « les animaux sont tous égaux, mais certains plus que d’autres ».
Cette histoire nous explique aussi pourquoi les dystopies sont résistantes à la réalité alors que les utopies en meurent. Les dystopies ont pris en compte le fait qu’un monde ne peut être parfait et heureux qu’au dépens de l’imperfection et du malheur d’un autre monde tout comme le bien à besoin du mal pour exister. Chez Orwell l’utopie d’un monde où tous les animaux sont égaux échoue avec la prise de pouvoir des cochons qui ont compris que leur rêve ne pouvait se passer de larbins, et que cette domesticité ne pouvait exister par libre consentement de chacun mais bien par contrainte imposée par une autorité supérieure. A tout faire, les cochons ont préféré être ceux qui se reposeraient, d’autant plus que la masse des animaux semblait vraiment prédisposée à se laisser tondre démontrant de ce fait qu’il existait dans la nature et l’équilibre des groupes sociaux non seulement un besoin de domination pour les uns mais un véritable gout à être dominé pour les autres. Les cochons n’ont eu qu’à jouer sur les cordes du sacrifice, de la valeur rédemptrice du travail, de l’effort de chacun pour le bien de tous pour justifier l’existence d’une hiérarchie parasite mais tellement nécessaire à assumer le destin de la ferme et à éclairer les masses de leur savoir.
Au fond les Dystopies des uns ne sont jamais que les utopies des autres et elles réservent leurs mondes et merveilles à qui sait se servir. De ce fait les si les dystopies résistent à la réalité c’est avant tout qu’elles se confondent avec elle.
A l’inverse les utopies sont par essence contraires à la réalité puisque c’est justement ce qui les en distingue et finit par les qualifier, et si l’œuvre littéraire peut faire illusion, l’expérimentation fait très vite apparaître les failles de l’idéologie. Or c’est là encore ce qui distingue nos deux concepts. En effet si les utopies acceptent de risquer l’épreuve de la réalité, il n’est pas certain que les dystopies le fassent. Étonnant alors que nous avons prétendu que dystopie et réalité ne faisait souvent qu’un. Mais l’affaire est un peu plus subtile et il faut nous en expliquer.
Le caractère contraignant des dystopies met l’accent sur les moyens de coercition utilisés par les élites dans le but de conserver leur autorité jusqu’à en faire une obsession. Cet état d’alerte constante fixe l’attention sur toutes les activités de prévention du risque et maintient l’élite minoritaire dans une situation d’attente incertaine peu propice à la jouissance de ses acquis. En d’autres termes l’élite trop occupée à préserver son pseudo bonheur, ne se risque jamais à le vivre faute d’y perdre en vigilance. De ce fait l’élite dystopique ne fait jamais qu’imaginer et même fantasmer un bonheur qu’elle n’expérimentera véritablement jamais faute d’être trop occupée à en préserver la possibilité d’en jouir. Alors si les dystopies résistent à la réalité c’est en partie parce qu’elles évitent d’y expérimenter leur idéal laissé à l’état de projet, d’alibi ou comme nous venons de le dire de fantasme.
Tout au contraire En se confrontant au réel les utopies bien plus courageuses et honnêtes réalisent que leurs mondes fermés nient l’impératif besoin des cellules vivantes de se confronter à leurs semblables, pour définir et conquérir de nouveaux territoires. Elles réalisent que l’homme à besoin d’insatisfaction et de risque pour le pousser sur le chemin des conquêtes et des découvertes afin d’y inventer ses propres mondes parfaits, et ce sera par l’inquiétude née de l’inégalité qu’il atteindra ses sommets. Alors il est vrai qu’elles se perdent sans doute dans l’expérience mais elles en livrent la leçon. Alors devant la déception des utopies et le danger des dystopies, il ne reste à l’homme que les promesses de mondes parfaits dont sont si gourmandes les religions. Calfeutrées dans un au-delà virtuel qui les met à l'abri de la confrontation à notre réalité, elles apparaissent comme l’ultime espoir de résoudre cette quadrature du cercle qui est le mystère la vie, et dont la mort semble être la seule réponse acceptable.
Lire la suite ...