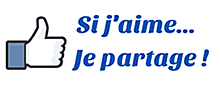Dans le Languedoc, en revanche, l'hérésie résiste. Et prolifère, même, sous le regard complaisant, voire bienveillant, de certains prélats et de la plupart des grands seigneurs locaux. Proche de l'Espagne, qui est encore celle des trois religions, la région est réputée pour sa tolérance religieuse ; elle est aussi jalouse de son indépendance et rejette l'autorité du pape comme celle du roi de France. Les fiefs des comtes de Toulouse et de Foix, comme ceux du vicomte Raymond Trencavel, constituent une terreau plus que favorable au développement de la « nouvelle foi ».
En 1167 un concile Cathare(1) se tint à Saint-Félix-de-Caraman (aujourd'hui Saint-Félix-Lauragais), près de Toulouse. Ce concile marquait la véritable rupture entre cathares et catholiques par la création d'une Église Cathare parallèle à l'Église Catholique Romaine. Cinq Églises Cathares, chacune dirigée par un évêque, s'y épanouissent bientôt, dans l'Albigeois, le Toulousain, le Carcasses, l'Agenais et le Razès. Refusant toute hiérarchie, à l'image de l’Église primitive, la communauté cathare s'y organise suivant deux niveaux seulement : les simples croyants et les prêtres. Ces derniers se partagent entre la prédication et la vie en communauté, dans des « maisons de parfaits » au cœur des villes et des villages, couvents ouverts où ils côtoient librement le reste de la population, qu'impressionne leur mode de vie très réglé : prière, jeûne, interdiction de manger de la viande, chasteté et, surtout, respect d'un idéal de pauvreté. Ainsi, c'est d'abord par l'exemple que les parfaits, souvent issus de la bourgeoisie et de l'aristocratie, prêchent leur foi.
(1) Source : Guillaume Besse, Histoire des ducs, marquis et comtes de Narbonne
Lire la suite ...