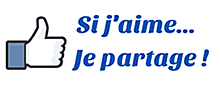De ce nombre se détache un dieu caractérisé par deux gerbes de flammes ondoyantes, qui lui sortent du dos et des épaules et lui font comme des ailes de feu. Il est représenté en général dans un étrange décor qui éveille une fois de plus notre curiosité. Le dieu en question, visible jusqu'aux genoux ou seulement jusqu'à la taille, apparaît derrière une montagne dont le sommet se termine parfois en double pyramide. Au premier plan, en avant de cette scène, qui semble avoir l'horizon pour théâtre, deux autres personnages ouvrent les battants d'une grande porte et servent, à l'occasion, d'introducteurs aux dévots qui se présentent avec des offrandes. Comment est-il possible d'interpréter cette représentation bien mystérieuse ?
Quelques experts en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un temple du dieu et des portiers qui en surveillaient l'entrée. D'autres, au contraire, sont allés chercher beaucoup trop loin une signification peu vraisemblable, parfois guidée par des préoccupation bibliques mal placées. Ils voient par exemple dans ces monticules et dans la porte qui les précède une allusion à la Tour de Babel, sur les ruines de laquelle se dresserait un dieu vengeur. L'opinion plus modérée qui propose que ça représente les sept portes infernales, mentionnées dans la célèbre légende d'Ishtar, n'est pas plus acceptable car il est impossible de faire du dieu aux ailes de flamme une divinité souterraine et, comme il a été dit, le sinistre gardien du monde des morts d'où l'on ne revient pas.
Le dieu flamboyant
Tu ouvres la porte du ciel,
et lui répétait, le soir :
Que la porte du ciel te soit obéissante.
Quant aux gardiens de ces portes, coiffés habituellement du bonnet à double corne, ce sont des divinités secondaires attachées au dieu principal, des génies du soir et du matin, de l'Orient et de l'Occident, analogues aux Heures grecques, malgré la différence des sexes, ou bien encore aux Dioscures.
Ces idées sont d'ailleurs si simples, elles répondent si bien au sujet et viennent si naturellement à l'esprit qu'on ne s'étonne pas de les voir aujourd'hui adoptées par le plus grand nombre, comme l'explication courante de la curieuse représentation gravée sur les cylindres.
Nous trouvons là juxtaposées, plutôt que combinées, deux conceptions de l'imagination populaire, qui sont d'ordre différent. L'image des portes du ciel est d'essence poétique; c'est purement une allégorie, une métaphore réalisée par le dessin. L'autre scène au contraire, tout en donnant au soleil la forme humaine, divinisée par des attributs, le fait agir et se mouvoir dans le cadre réel de l'horizon et des montagnes; nous sommes devant un véritable paysage, résumé en quelques traits, et le dieu reste
en contact avec la nature. L'incohérence qui résulte d'un pareil doublement d'images est loin du reste de répugner à la poésie primitive; l'impression d'ensemble en devient plus fantastique, et ces portes, ouvertes sur le monde, prennent les proportions de l'infini. Même chez les Chaldéens, c'est dans un premier anthropomorphisme, mêlé au sentiment de la nature, qu'il faut chercher, croyons-nous, l'explication de cette mythologie figurée, plutôt que dans des constructions cosmologiques, trop précises, agencées et raccordées après coup sous l'influence du dogmatisme sacerdotal.
Le lever du soleil
Le soleil, à son lever, avait, dans la superstition orientale, une puissance particulièrement bienfaisante.
C'était l'heure où il chassait les démons de la nuit et dissipait leurs maléfices. Il ne faut pas oublier que les cylindres, tout en servant de cachets, étaient aussi des talismans; les images qu'ils imprimaient sur
l'argile avaient une influence protectrice, une valeur de bon augure. On s'explique ainsi que la représentation du soleil levant y soit figurée de préférence.
Le dieu, à ce moment précis de son apparition, est toujours vêtu d'une longue robe, et il élève souvent de la main droite un attribut dont la forme et la nature sont ici nettement caractérisées : ce n'est ni une arme ni précisément un rameau, mais bien une palme. Faut-il déjà, dans le symbolisme chaldéen, en faire l'emblème classique de la victoire, exprimant le triomphe de la lumière sur les ténèbres ? Il serait peut-être plus simple d'y reconnaître, à l'origine, l'attribut naturel du dieu qui protège les palmiers et qui en mûrit les fruits. Du reste, les deux interprétations ne s'excluent pas nécessairement, et le geste a quelque chose de triomphal.
Ce premier acte du drame solaire n'est pas le seul qui soit figuré dans l'iconographie chaldéenne. Il y a là une action qui se poursuit et qui fait naître en se développant d'autres péripéties non moins expressives, qui mettent en scène de nouveaux acteurs. Le fait est démontré par quelques cylindres de la collection du Louvre.
La montagne de l'Ouest
Infiniment plus rares sont les représentations où le dieu Soleil s'empare d'une montagne, sans doute distincte de la précédente, non plus par simple escalade, mais en livrant bataille à un premier occupant, dieu comme lui. Ici, la porte du ciel ne figure plus; nous sommes à une autre étape dans la marche diurne de l'astre. Les deux acolytes divins, qui tout à l'heure jouaient le rôle de portiers, n'ont pas cependant abandonné leur chef; ils le suivent maintenant et font partie de son escorte guerrière, portant ses armes sacrées, une masse d'armes de rechange et le bâton coudé qui une fois lancé revient toujours à la main. Le dieu lui-même se montre dans un redoutable appareil de combat. Complètement nu, la taille seule sanglée d'une étroite ceinture, tout environné de flammes, qui lui sortent même des jambes, il aborde de près son adversaire et le menace de sa masse d'armes. Après lui, pour lui prêter main forte, vient encore un terrible personnage, qui n'est caractérisé par aucune arme ni par aucun attribut, si ce n'est qu'il brûle et flamboie de la tête aux pieds; c'est l'incendie qui marche. Il ne faut pas hésiter, croyons-nous, à y reconnaître le démon du feu ou mieux le Feu en personne, plus d'une fois célébré dans les hymnes de l'ancienne Chaldée.
Quant au dieu menacé d'être brûlé vif, rien n'est plus curieux ni plus naïvement expressif que son attitude. Assis sur la montagne, dont il était jusque-là le paisible possesseur, nu comme son ennemi et n'ayant aussi qu'un lien autour de la taille, il est de plus tout à fait désarmé contre cette irruption soudaine. Aussi se contente-t-il d'écarter ses mains ouvertes et abaissées dans un geste d'impuissante protestation. Il semble cependant qu'il n'ait pas cédé la place sans résistance; c'est ce qu'indiquent plusieurs cylindres de plus petite dimension, dont le Louvre possède un bon exemplaire. Au revers de la représentation précédente, sommairement reproduite, on voit une scène de palestre où les deux adversaires se mesurent corps à corps; mais déjà le dieu de la montagne a fléchi le genou et la victoire du Soleil n'est pas douteuse. Dans plusieurs variantes curieuses de la collection de Clercq, l'agresseur saisit son ennemi par sa longue barbe; souvent encore il tient sa masse d'armes et ne l'abandonne que vers la fin de la lutte.
La lutte contre le dieu de la montagne
Il est impossible de ne pas ouvrir une parenthèse pour dire incidemment quelques mots de la seconde scène gravée sur le revers du même cylindre. C'est encore une des luttes où le dieu Soleil était engagé, d'après la légende chaldéenne; mais celle-ci appartient à une autre partie de son histoire. Au milieu des montagnes, qui forment derrière les figures comme deux panneaux rocheux, le dieu aux ailes de feu, dont le caractère sidéral est encore accentué par une étoile qui rayonne entre les cornes de sa coiffure, a trouvé un nouvel adversaire dans Eabani, le monstre moitié-homme, aux jambes de taureau, vivant avec les bêtes sauvages. Les fragments conservés de l'épopée chaldéenne racontent bien en effet par quelles séductions le Soleil l'avait attiré et retenu dans la ville d'Erech; mais ils ne parlent pas de violence. Ici c'est de force que le dieu lui-même s'empare du monstre, l'arrêtant à la fois par sa queue de taureau et par l'une de ses cornes, sans craindre la massue recourbée dont il est armé. L'épisode est de toute manière inédit; seulement rien ne prouve qu'il se reliât en quelque façon à la lutte ignée contre le dieu de la montagne, et ce n'est peut-être qu'un simple pendant à la scène gravée sur le côté opposé du cylindre.
Le coucher du soleil
Ce qui nous conforte dans l'idée d'un assaut livré à la montagne de l'Occident est un autre cylindre qui représente le combat terminé et le dieu aux ailes de flamme se reposant après sa victoire. Assis à son tour sur la montagne qu'il vient de conquérir, il tient encore en main la masse d'armes. Dans le champ, des deux côtés de la figure, sont suspendues une autre masse d'armes et une aiguière ou un vase à verser, double symbole du repos après la lutte. Ajoutez que les portes du ciel sont ici de nouveau
représentées avec leurs gardiens habituels.
Telle est bien l'impression que produisent sur l'imagination populaire les splendeurs du soleil, quand il approche de son coucher. Le moment où il semble se reposer à l'horizon est comme un triomphe où se manifeste sa royauté. Les Grecs modernes, pour exprimer le fait que le soleil se couche, disent d'un seul mot qu'il « règne », expression superbe qu'ils ne semblent pas devoir à l'antiquité classique. La représentation gravée sur notre cylindre éveille une idée toute semblable.
L'apparition des étoiles et des démons de la nuit
La représentation rappelle de très près celle par où nous avons commencé, l'image du dieu paraissant à demi derrière la montagne; mais elle est d'un style particulier et elle offre des détails qui ne sont pas ordinaires. On remarquera surtout que les six lignes ondulées figurant les ailes de flamme se terminent par autant d'étoiles. Si, contrairement à l'opinion opposée plus haut, la scène pouvait se rapporter, dans certains cas, au soleil descendant derrière l'horizon, aucune variante ne s'y prêterait mieux que celle-ci. Comme dans un exemple précédent, les battants de la porte sont surmontés de deux lions. Les deux gardiens n'ont pas cette fois la coiffure munie de cornes; en revanche, ils sont armés de bâtons recourbés.
Ces armes ne leur sont point inutiles; car ils ont à contenir un horrible démon, aux pieds d'aigle, à la tête décharnée, assez semblable à celui qui figure le Vent du sud-ouest dans plusieurs représentations connues. Des traits presque effacés semblent indiquer des ailes et même quelques flammes qui entourent le monstre. Ne serait-ce, sous une forme plus accentuée, que le démon du feu ? Mais ce serait plutôt un de ces esprits mauvais que la montée du jour met en fuite et qui recommencent à rôder sur la terre à l'approche du soir. Si réellement il y a des flammes autour de lui, on peut supposer qu'il paie ainsi sa témérité à braver les feux du soleil.
Le symbolisme chaldéo-assyrien
L'idée de représenter les dieux sur des animaux réels ou imaginaires est une des formes les plus originales du symbolisme chaldéo-assyrien. Cependant les groupes de ce genre, assez fréquents à l'époque assyrienne et aussi chez les populations de l'Asie Mineure, sont tout à fait rares sur les monuments de la haute antiquité chaldéenne. Pourtant il en existe un exemple, d'autant plus intéressant que le procédé n'est pas encore devenu banal et commun à toutes les divinités.
Du même pas s'avancent l'un derrière l'autre deux monstres exactement pareils, que l'on pourrait, par anticipation, appeler apocalyptiques. Lions par le corps, par leurs membres antérieurs et par leurs têtes abaissées, dont les terribles mâchoires, ouvertes en cisailles, vomissent des torrents d'eau ou de feu, ils sont aigles par leurs puissantes ailes étendues, par les serres de leurs pattes postérieures et par leur queue de plumes en éventail. C'est en somme une des formes que la démonologie chaldéo-assyrienne prête le plus souvent aux puissances destructives, aux esprits du mal. Seulement l'art chaldéen y ajoute une grandeur étrange, surtout par la petitesse relative des figures divines que ces monstres portent à travers l'espace, non pas simplement, comme plus tard, posées sur leur dos, mais dressés en avant sur le garrot de la bête, vers la naissance des ailes déployées, qui semblent les soulever.
Les êtres mythologiques de Chaldée
De pareilles images appartiennent évidemment au cycle des divinités qui personnifiaient les troubles de l'atmosphère, comme Bin, ou mieux Ramman, le dieu des tempêtes, avec sa compagne, la déesse Sala, et les autres êtres mythologiques qui forment leur cortège. Les monstres qui les portent figurent les ouragans, les souffles orageux, qui se confondent, dans les incantations chaldéennes, avec toute une classe de démons malfaisants.
Par cet exemple, comparé à ceux que nous avons empruntés aux représentations solaires, on peut juger avec quelle puissance tragique et quelle fantaisie grandiose l'imagination des artistes chaldéens avait su dramatiser la marche des phénomènes célestes et l'éternel combat des forces de la nature.
D'après un texte original de Léon HEUZEY juste un peu rafraîchi par dramatic.fr