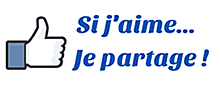Dans un songe Ptolémée aurait reçu l’ordre de faire transporter à Alexandrie la statue d’un jeune homme qui se trouvait au Pont. Ce sera Sérapis, un mélange entre Osiris et le taureau Apis, que l'on va débarrasser de sa tête de taureau et à qui l'on accorde une épouse : Isis. Cette statue fut installée dans un sanctuaire d’Alexandrie consacré à Isis et Sérapis. Il existait déjà à Memphis un sanctuaire consacré à Osiris-Apis. Le O étant l’article, le nom Sérapis est une déformation de O sir-apis, le dieu taureau égyptien.
Mais Ptolémée entendait offrir une version hellénisée de la divinité, aussi fit-il faire une statue de Sérapis qui avait perdu tous ses aspects zoomorphes de la divinité égyptienne, pour acquérir le look de Zeus. Par cet artifice il s’offrait un dieu à la fois égyptien et grec susceptible de convenir à tous. Au culte de Sérapis fut ajouté celui d’Isis et d’Horus (appelé Harpocrate), donnant ainsi naissance à une trilogie modernisée qui fut appelée le « triade alexandrine ».
Intervient ensuite un personnage central : Arsinoé II, épouse de Ptolémée II, qui joue un rôle important dans la vie publique et créé une flotte navale. Elle sera divinisée et associée à deux divinités : Aphrodite et Isis. Dans le sillage de la reine, Isis va partir à l'assaut de la Méditerranée orientale. La cellule familiale constituée d'Isis, de Sérapis et de Horus est plébiscitée. En 88 av. J.-C., les troupes de Mithridate saccagent l'ile de Délos, port franc fréquenté par des commerçants, des armateurs, des marchands, où se trouvaient des temples égyptiens. Paradoxalement, cette destruction contribue à la diffusion du culte. Une diaspora cultuelle et économique va s'installer à Pompéi, en Thessalonique, en Espagne, et fonder des temples égyptiens.
Le sérapisme se répandit dans tout le Moyen-Orient jusqu’en 391 date à laquelle le patriarche d’Alexandrie, Justinien, le fit interdire.